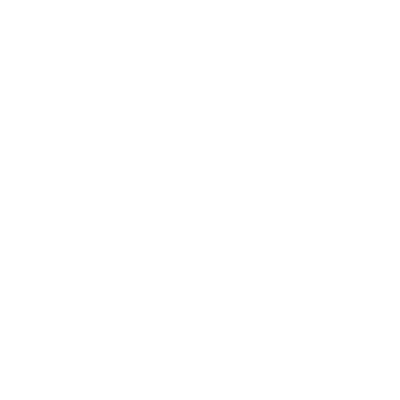Benoît Vincent, au sein du Labo de Ciclic, développe le projet "SITUER", une mise en fiction de six régions naturelles du Centre-Val de Loire : la Beauce, le Berry, la Brenne, le Perche, le Chinonais et la Touraine. L'écrivain et naturaliste propose une cartographie littéraire, une tentative de traduction esthétique de ces territoires naturels emblématiques, une invitation à parcourir, penser et lire nos paysages d'un regard neuf. Il nous livre ici un extrait de son travail en cours...
Bonhomme de chemin
Perche [Faux Perche ou Perche vendômois, Perche gouët,
Perche sarthois, Perche dunois, Grand Perche]
Centre-Val de Loire – 41 Loir-et-Cher [Blois/ Vendôme– Romorantin-Lanthenay]
Well, I saw an old man
walking in my place
And he looked at me,
it could have been my face
His words were kind
but his eyes were wild
[Neil Young]
Tu chemines. Tu chemines sans te retourner. Sans te retourner, par les chemins creux, tu avances. Est-ce que tu fuis quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que tu es pressé pour te rendre quelque part, je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais rien de toi.
Toujours est-il que tu chemines. Toujours, tu chemines. Il faut bien avancer.
Est-ce le jour qui décline ? Ce crépuscule ? Est-ce l’aube encore incertaine ? Je n’en sais rien non plus. Je ne sais pas grand’chose.
*
La répétition des gestes devrait faire passer le temps plus vite, mais c’est tout le contraire qui se produit. La répétition des gestes, qui peu à peu transforme la main en outil, le corps en machine et l’esprit en programme, en faisant mine de nier le temps, en vérité l’arrête et le fige, en quelque sorte le dénature. Le temps qui ne manque plus, le temps fermé, est une catastrophe.
Alors, chacun n’avait de cela qu’une vision infime, tout à la fois personnelle, intime, et donc difficilement communicable (un peu de honte donnait son vernis) et une vision partiale, un peu pour les mêmes raisons (on ne se plaignait pas devant les autres), un peu parce que cela était nouveau et que ce qui est nouveau impressionne, en ce que l’on apporte plus de crédit à la forme nouvelle censée traduire un certain progrès, une certaine amélioration du monde, qu’à ses propres sentiments, se jugeant soi-même sans doute trop lent, ou trop retors, ou trop faible pour supporter la vague qui porte vers l’« émancipation ».
*
Je sais que, depuis ma fenêtre, la cour pavée disparaît sous de gros flocons et sans doute en est-il de même de la rue devant la maison, du village, de la ville voisine et des espaces variés entre les deux, les champs où tu as travaillé jadis, l’usine où tu travailles maintenant… les vergers où se déroulaient de longues journées aussi, où tu as dormi aussi et où tu t’es caché… les haies que tu as pensées, façonnées, tressées, accrochées et même arrachées… les carrières où tu as usé les outils et le corps, jusqu’à l’épuisement.
*
Les aïeux parlaient, par un tour étrange qui doit être, sans doute, le propre de l’histoire, à savoir, plutôt, le génie singulier du récit, je veux dire de la narration, et, à travers leurs paroles, les aïeux dépeignaient un monde qui nous semblait à tous rendu inaccessible, un monde désormais révolu, dont la violence et la dureté paraissaient une formalité au regard de ce que la cohésion et la connivence du groupe semblait y représenter.
Lorsque furent éparpillés les débris fumant des dernières maisons, on chercha à former de nouvelles communautés, mais celles-ci étaient plus tristes, comme résignées, comme trop conscientes de leur semblance nouvellement construite...
*
Il neige, et ce n’est pas souvent, mais ce paysage te va bien. La neige et le froid ralentissent le temps, et tu apprécies le temps ralenti. Pourtant tu chemines, tu t’agites dans la marche, non sans rigueur bien sûr, mais quelque chose, en toi, autour de toi, semble faire menace, menace sans danger, menace sourde, mais menace, poids, comme ce qu’on sait qui peut surgir, comme ce qui surgit, au contraire de tout ce qui ne surgit pas, ne surgit jamais. Comme les vaches, le bétail. Même le cheval.
*
Mais la répétition fatigue. Travailler fatigue. Travailler comme cela fatigue.
Il est loin le temps où il s’agissait de cultiver, entretenir, choyer, avec les bêtes, un lopin de terre à proximité du village. La vie était alors rythmée par la ferme et ses saisons. Les semailles et le vêlage, le nourrissage et le labour... On regarde aujourd’hui tout cela l’œil amusé, avec le recul d’un almanach, parce que pour une part cette matière nous est devenue étrangère (même si nos enfances ont souvent un pied à la campagne), et un peu aussi parce que toute cette mythologie (qui accompagnait le travail et la vie en tant que tels) a été façonnée de toute pièce, pour nous comme pour eux.
Puis, en quelque sorte, est arrivé le train.
Une dit : « Avec l’arrivée du train c’est tout le paysage qui change. C’est pas seulement pour le train, mais tout ce que la venue du train implique. En somme le train passe dans notre pays, qu’est pas tellement fait pour le train d’ailleurs, et faut lui trouver de la place.
C’est que le train est comme un long cordeau qui vient, on ne sait pas trop d’où, et qui va, on ne sait pas trop où, même si on sait qu’il vient de Chartres et qu’il mène jusqu’à la mer ou presque, à Bordeaux, mais c‘est loin Bordeaux ; eux, ceux du train, ils disent “c’est pratique pour vous, vous pouvez aller voir vos familles ou aller à la mer en vacances”.
Nous on veut bien qu’il passe par chez nous, mais pour ce qui est des familles ou des vacances… Déjà, on a toujours quelque chose à faire ici, on n’a pas le temps de s’ennuyer… Puis la mer… on a la nôtre ici, en moins chic peut-être mais quand même, puis question d’aller voir ailleurs, les gens d’ailleurs, ils ne sont pas toujours contents de nous voir débarquer, d’ailleurs ils ne viennent pas tellement nous voir non plus... moi je crois que finalement les gens ne sont pas si mal chacun chez eux.
Et bon ‘faut que le train il serpente comme ça, sans fin, avec tout son système de rails et de gares, et c’est facile pour lui quand c’est dans les champs ouverts, comme tout le quartier jusqu’à Châteaudun, mais chez nous c’est une autre histoire. Parce que cette ligne droite, et seule, elle doit entrer en contact avec nos lignes à nous qui sont nombreuses et en tous sens, on dirait une pelote de fils, si on veut. »
*
Les enfants, qui ont grandi dans la ferme, ont échangé leur temps de travail contre le temps d’école. Ils ont emmagasiné de nouveaux chemins, de nouveaux paysages, et puis ils sont partis. Pendant ce temps les haies progressaient, les champs se fermaient, on manquait de bras. On a alors cédé à la facilité, et la facilité c’est la machine, et la machine c’est moins de bras, moins de chevaux, et la machine c’est le progrès. A la brassée d’un peu de poules, d’un peu de bétail, d’un peu de froment, d’un peu de fruits, on a substitué des champs, immenses, rectangulaires et uniformes.
*
Je viens donc te rendre visite, toi qui dessines les paysages, c’est-à-dire toi qui parles la langue des lignes et des formes, et de leur confrontation. Toi qui parles la langue qui est l’interface entre l’œil et la main.
L’un, le premier, dit : « Pour nous, cette force [le travail du paysage], ça faisait peloton, un petit moteur de courage et d’espoir, face à nos bordées qui s’ouvraient de plus en plus, faces aux champagnards qui nous entourent ; pas plus tard qu’hier M. m’a dit que les pièces du gros Pierre avaient été complètement défrichées, encore un chemin creux et ses bordures, les plesses et les tresses, qui sont partis en feu et fumée. »
Je saisis qu’il est plus facile d’apprendre à faire de robustes trognes à des gens de loin qu’à des bonhommes de foin. Il reprend : « Ils disent que c’est le progrès. Vous devriez vendre, ouvrir, ils disent, ouvrir ! ouvrir ! C’est leur obsession ! S’ils viennent ici, avec leurs assureurs et leurs huissiers, ils voudraient bien ouvrir toute la France, et comment ! »
*
Je te vois marcher, avancer, malgré un drôle de vent qui souffle maintenant en sens contraire. Rabat ta casquette et projette parfois dans tes yeux du grésil solide comme du sable.
Le vent, c’est tout un art que de passer d’un croisement à une côte, dans la nuance subtile des agencements, au sens de l’ajustement des reliefs. Toi tu connais les traverses, les halliers et les essarts, tu sais raccommoder les écarts, avec les foyers.
*
Eux : « Ouvrir, éventrer, je pense souvent à ça. Nous on a des parcelles, des enclos, on a le bocage : on ne peut pas ouvrir comme ça, inconsidérément, on a des contraintes. Nous, c’est tout un art de l’abri, de la vannerie, du tissage, que nous avons développé. Nos chemins creux, nos haies, nos arches tressées de bois, nos trognes, c’est tout un art de l’enclosure qu’on a. Eux voudraient tout ouvrir, faire tomber les arbres et les arbustes, combler colmater les creux, dénouer délier tous les nœuds et les liens que pendant des siècles nous avons patiemment faits. »
Une autre : « Beaucoup d’enfants percherons sont allés travailler dans les fermes beauceronnes "modernes" (sans haies, sans fossés, sans trop d’arbres et d’obstacles), qui les ont fait rêver… cela explique certainement (en plus de la politique agricole, des remembrements, des drainages) et en raison de la proximité géographique, comment, revenus au pays, beaucoup d’entre eux ont imité ce modèle et son paysage… »
Un autre : « Quant au chemin de fer, il accompagne depuis presque un siècle et demi cette révolution industrielle et agricole qui a vidé les campagnes : depuis la ligne Paris-Bordeaux, les voies métriques qui avaient abouti entre les deux guerres, et pour quelques années seulement, à un maillage maximum du territoire, puis l’abandon de ces lignes au profit de celles à grande vitesse…
Nous, on a les chevaux.
Ils ne vont tout de même pas croire qu’on va se passer de nos chevaux parce que le train arrive, alors même qu’on a fourni la capitale, la même capitale que celle du train, en chevaux depuis des générations ? Même aux Amériques. Même aux Amériques. »
*
Je te vois marcher, tu cherches à ne pas quitter le chemin creux. Tu cherches à rester dans la forêt.
Le crépuscule a d’abord doré les houppiers, avant même l’embrasement du soleil qui projetterait ses rayons rasants au visage et aux yeux. Il restait quelques fleurs de l’été : toute brûlaient et s’enveloppait dans le couchant. Les troncs, par contre, faisaient déjà saillis, ombres noires sans mouvement comme jaillis du sol, tacitement reconduits.
Tu cherches, haletant, petite foulée, à ne pas sortir à découvert. Ne pas te faire remarquer. Modeste. Un passereau. Un colimaçon.
*
Je vois le dessin que tu fais. Je visite ton atelier. Je vois les bois flottés, les fleurs séchées, les cailloux ramassés ; je vois les crânes de petits animaux non identifiées, toutes les petites dents d’émail éclatant, sagement alignées. Je vois les bocaux, les planches d’herbier, les gravures, les lentilles, les outils, les gabarits, les chutes. Toute la panoplie des crayons gras, des aquarelles, des fusains. Et tous les papiers.
Nous passons dans le jardin. Je vois qu’il est une pièce de la longère. Nous prenons une orangeade. Elle dit : « Nous sommes modestement revenus ici. J’ai travaillé à Paris, à Lyon, à Bordeaux, que sais-je, mais nous sommes revenus ici, à l’écart de la pulsation urbaine. C’est un choix. Je ne pouvais pas m’éloigner davantage du bocage. » Puis : « Je joue aussi un peu de la vièle à roue. »
*
Suivre ton chemin, avec ses trognes douces et rassurantes (rassurantes figures totémiques, sauvages et monstrueuses mais chamaniques aussi, c’est dire la parentèle) ton bonhomme de chemin.